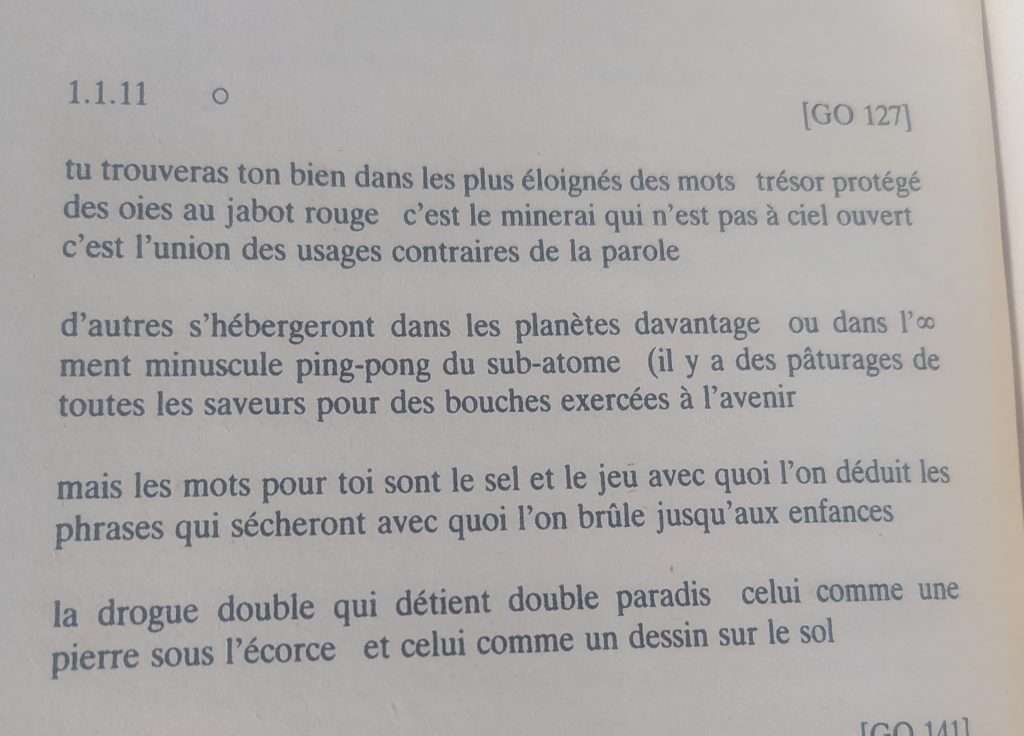The sound of silence
is all the instruction
You’ll get
Jack Kerouac
Catégorie : Chrestomathie
haiku
Neige | Édouard Levé
La neige recouvre les objets d’une couche qui les uniformise. Les couleurs disparaissent, les formes s’adoucissent. Elles se fondent dans un tout monochrome qui réduit le monde à un dessin. Les bruits sont étouffés. Les identités se dissolvent. Les voitures n’ont plus de marque, ce sont des formes simplifiées. Emmitouflés, les passants sont anonymes. Un arbre est un arbre et non cet arbre. Il n’y a plus de détails, plus d’histoires. C’est la fin des distinctions. La neige est démocratique. Le monde est enfin lisible, comme une collection de formes abstraites.
La neige est rare.
Sous la neige, la lumière est diffuse. Il n’y a pas d’ombres. La neige produit la régularité.
La neige ne dure pas. Sa brièveté contient l’annonce de sa disparition. Sa couleur est celle des chairs mortes. Elle congèle et ralentit la vie. Le monde, devenu temporairement un mort vivant, m’est soudain plus familier. Je suis plus vivant entouré de mort que dans l’étouffant été où la vie prolifère.
Je préfère la neige à la campagne que dans une ville. Un phénomène naturel a sa place dans la nature. Dans une ville, la neige est sale et fond vite. Elle a moins de prise sur les objets urbains, verticaux, que dans la campagne, horizontale. Un pré lui convient mieux qu’une façade d’immeuble.
La neige m’apaise. Le monde est simple : les couleurs disparaissent, les formes s’adoucissent, les mouvements ralentissent, les bruits s’étouffent. Dehors, il y a moins de gens, moins de voitures, moins de lumière, moins de mouvement, moins de passage. Le paysage devient un désert, un arrêt sur image, une statue, un ralenti.
La neige craque sous mes chaussures. Par son bruit, chaque pas existe plus.
Dans le froid qui accompagne la neige, mes poumons existent plus, ma trachée artère existe plus, la peau de mon visage existe plus, mes doigts refroidis existent plus. Dehors, pour exister normalement, mon corps se dépense plus. Ma gymnastique matinale devient superflue.
Quand il neige, la nature accomplit poliment son programme saisonnier. Ni déception ni trahison.
Neige fond : trahison.
L’Ardoise – Francis Ponge
L’ardoise – à y bien réfléchir c’est-à-dire peu, car elle a une gamme de reflets très réduite et un peu comme l’aile du bouvreuil passant vite, excepté sous l’effet des précipitations critiques, du ciel gris bleuâtre au ciel noir – s’il y a un livre en elle, il n’est que de prose : une pile sèche ; une batterie déchargée ; une pile de quotidiens au cours des siècles, quoique illustrés par endroits des plus anciens fossiles connus, soumis à des pressions monstrueuses et soudés entre eux ; mais enfin le produit d’un métamorphisme incomplet.
Il lui manque d’avoir été touchée à l’épaule par le doigt du feu. Contrairement aux filles de Carrare, elle ne s’enveloppera donc ni ne développera jamais de lumière.
Ces demoiselles sont de la fin du secondaire, tandis qu’elle appartient aux établissements du primaire, notre institutrice de vieille roche, montrant un visage triste, abattu : un teint évoquant moins la nuit que l’ennuyeuse pénombre des temps.
Délitée, puis sciée en quernons, sa tranche atteint au vif, compacte, mate, n’est que préparée au poli, poncée : jamais rien de plus, rien de moins, si la pluie quelquefois, sur le versant nord, y fait luire comme les bourguignottes d’une compagnie de gardes, immobile.
Pourtant, il y a une idée de crédit dans l’ardoise.
Humble support pour une humble science, elle est moins faite pour ce qui doit demeurer en mémoire que pour des formulations précaires, crayeuses, pour ce qui doit passer d’une mémoire à l’autre, rapidement, à plusieurs reprises, et pouvoir être facilement effacé.
De même aux offenses du ciel elle s’oppose en formation oblique, une aile refusée.
Quel plaisir d’y passer l’éponge.
Il y a moins de plaisir à écrire sur l’ardoise qu’à tout y effacer d’un seul geste, comme le météore négateur qui s’y appuie à peine et qui la rend au noir.
Mais un nouveau virage s’accomplit plus vite ; d’humide à humble elle perd ses voyelles, sèche bientôt :
«Laissez-moi sans souci détendre ma glabelle et l’offrir au moindre écolier, qui du moindre chiffon l’essuie.»
L’ardoise n’est enfin qu’une sorte de pierre d’attente, terne et dure.
Songeons-y.
Jean Rouaud – Des hommes illustres
Les hauts murs forcent à lever les yeux. L’absence de couverture découpe un large rectangle de ciel où trempe comme un pinceau la pointe fine d’un cyprès. Peu de bleu qui inviterait à une échappée verticale, ou par flaques, comme des trous d’eau entre la masse des nuages qui roulent à gros bouillons depuis l’Atlantique, ou s’effilochent, mal cardés, ou moutonnent, petites pelotes cotonneuses qui annoncent les lendemains de pluie. Un bleu parcimonieux, pâle, à fresque. Un bleu pauvre face à l’éclatante richesse des gris, entre perle et cendre, chinchilla et suie, lavis mouvant qui superpose ses brumes. Si la tête vous tourne à suivre les nuées, baissez les yeux, ouvrez une huître, décortiquez une moule : toutes les nuances des ciels de l’Atlantique sont répertoriées dans la nacre de ses coquillages. L’été, ce pré de ciel au fond du jardin est envahi par des colonies de martinets et d’hirondelles qui font du toit de l’église leur résidence secondaire et occupent leurs vacances à décrire en vol de joueuses arabesques, grand corps souple ondulant à la manière des paramécies et alimentant de ses petits cris stridents la poignée de beaux jours.
Couteau de Lichtenberg | Jacques Roubaud
Sa vie lui apparut comme un couteau de Lichtenberg. Il empoigna le manche (le passé), et mit à sa place une tige de durée nouvelle, pure et vide: oubli. Mais était-ce bien encore cela, sa vie ?
Il changea ensuite la lame (son vieil avenir d’autrefois, usé et sali), non sans se couper plusieurs fois le doigt, par maladresse. Rien de sa vie n’était demeuré semblable, après ces transformations.
Alors il pensa que cela avait été une manipulation trop grossière pour rendre compte de ce qu’il venait de ressentir, que sa vie était plutôt le Navire des Argonautes, ou qu’il avait vécu en fait changeant une à une les planches vermoulues, les planches de la durée, chacune contenant un peu de son passé, un peu de son futur, les remplaçant une à une par de la durée neuve, d’un bois neuf, verni, en équilibre sur la jointure du présent; et que telle avait été sa vie jusqu’au moment où il n’était pas resté une seule planche intacte ayant appartenu à la première forme du vaisseau.
Sa vie ? Elle avait été ce vêtement dont chaque jour, dans la hâte, il avait remplacé un fil d’or usé par un fil de lin ou de laine, grossier, et quand tous les fils d’or de l’avenir avaient disparu, au terme d’un changement continu, insensible, il n’était resté que cela, terne. Mais pouvait-on encore parler d’une vie ?
Le retour de Hollande – Paul Valéry
Un voyage est une opération qui fait correspondre des villes à des heures. Mais le plus beau du voyage et le plus philosophique est pour moi dans les intervalles de ces pauses.
Je ne sais s’il existe de sincères amateurs du chemin de fer, des partisans du train pour le train, et ne vois guère que les enfants qui sachent jouir comme il convient du vacarme et de la puissance, de l’éternité et des surprises de la route. Les enfants sont de grands maîtres en fait de plaisir absolu. Quant à moi, je me berce toujours, dès que le bloc des wagons s’ébranle, d’une métaphysique naïve et mêlée de mythes.
Je quitte la Hollande… Tout à coup, il me semble que le Temps commence ; le Temps se met en train ; le train se fait modèle du Temps, dont il prend la rigueur et assume les pouvoirs. Il dévore toutes choses visibles, agite toutes choses mentales, attaque brutalement de sa masse la figure du monde, envoie au diable buissons, maisons, provinces ; couche les arbres, perce les arches, expédie les poteaux, rabat rudement après soi toutes les lignes qu’il traverse, canaux, sillons, chemins ; il change les ponts en tonnerres, les vaches en projectiles et la structure caillouteuse de sa voie en un tapis de trajectoires …
Même les idées, toujours surprises, traînées comme étirées par le torrent des visions, se modifient à la manière d’un son dont l’origine vole et s’éloigne.
Il m’arrive aisément que je ne me sente plus nulle part, et sois comme réduit à l’être abstrait qui peut se dire en tous lieux qu’il pense, qu’il raisonne, qu’il dispose, fonctionne et ordonne identiquement ; qu’il vit, et que rien d’essentiel n’est altéré ; qu’il ne change donc point de place. Ne faudrait-il à ce pur logicien qui nous habite, pour qu’il eût le sentiment du mouvement, qu’il observât des modifications bien extraordinaires, des désordres inconcevables, et sans doute incompatibles avec la raison ou la vie ?
C’est un grand miracle qu’il y ait en nous tant de mécanismes délicats assez insensibles au transport.
Mais, au contraire, l’être total, l’âme réelle du voyageur de qui l’absence va finir, quand chaque tour des roues le rapproche de sa maison, et qu’une boucle de sa vie va se fermer, est la proie d’étranges effets de sa transition. Ce qu’elle quitte, ce qu’elle éprouve dans l’instant, ce qu’elle prévoit et se prédit, se la disputent, se proposent et s’échangent en elle-même. Elle oscille entre ses époques que la précision du départ bien marqué, l’exactitude probable de l’arrivée séparent si nettement ; elle heurte au hasard le regret, l’espérance, les craintes, et les perd et les retrouve dans ses sensations. Son passé, son présent, son futur prochain sonnent en elle comme trois cloches bien distinctes, dont toutes les combinaisons se réalisent, se répondent, se brouillent et se composent curieusement. Jouant et reprenant sans fin tous les thèmes de l’existence, un carillon d’événements — accomplis, — attendus, — actuels, — accompagne le corps voyageur, habite une tête qui s’abandonne, l’amuse, l’inquiète, emprunte les rythmes de la route, orchestre des rêves, égare, endort, réveille son homme…
La nuit tombe. Il naît et meurt des feux terrestres, — postes soudains, signaux aigus, éclats subits de vies inconnues effleurées… Entre deux lueurs, mes yeux incertains dans la buée qui brouille les glaces, peu à peu cessent de voir une campagne déjà morte et simplifiée par le soir, qui s’écoule indéfiniment vers les lieux et les jours passés.
Il me semblait à la fin de ne plus apercevoir que tous les états de l’eau, — l’eau neige, — l’eau glace, — l’eau vive, — l’eau flaque mirant l’eau nuée, — l’eau vapeur dont les volutes libérées se détordent, se disloquent, s’attardent et se dissipent après nous. L’eau multiforme compose, presque à soi seule, la substance d’un pays trouble et variable dont la suprême clarté du crépuscule interprète encore les blancheurs et pâleurs précipitées.
Que les lampes s’allument, et sur la vitre tout à coup se vient peindre un fragment de visage. Un certain masque s’interpose, portrait d’homme qui demeure lumineux et constant à la surface de cette fuite de plages sombres et neigeuses.
Je m’apparais immobile et chaudement coloré sous le verre ; et si je m’approche un peu de ce moi morcelé d’ombres qui me regarde, je l’éclipse, je m’abolis, je deviens le chaos nocturne.
Mais, au contraire, l’être total, l’âme réelle du voyageur de qui l’absence va finir, quand chaque tour des roues le rapproche de sa maison, et qu’une boucle de sa vie va se fermer, est la proie d’étranges effets de sa transition. Ce qu’elle quitte, ce qu’elle éprouve dans l’instant, ce qu’elle prévoit et se prédit, se la disputent, se proposent et s’échangent en elle-même. Elle oscille entre ses époques que la précision du départ bien marqué, l’exactitude probable de l’arrivée séparent si nettement ; elle heurte au hasard le regret, l’espérance, les craintes, et les perd et les retrouve dans ses sensations. Son passé, son présent, son futur prochain sonnent en elle comme trois cloches bien distinctes, dont toutes les combinaisons se réalisent, se répondent, se brouillent et se composent curieusement. Jouant et reprenant sans fin tous les thèmes de l’existence, un carillon d’événements — accomplis, — attendus, — actuels, — accompagne le corps voyageur, habite une tête qui s’abandonne, l’amuse, l’inquiète, emprunte les rythmes de la route, orchestre des rêves, égare, endort, réveille son homme…
(…)
Jack Kerouac
Lisant mes notes —
La mouche passe
De la page au doigt
Reading my notes —
The fly stepping from
The page to the finger
Pierre Alfieri
chez nous tous les messages
dépassent leur cible
je n’oublie pas la carte
postale de mon père
Gracq sur les graffitti dans les pissotières
Celui qui écrit sur les murs des pissotières connaît le plus haut sérieux auquel peut prétendre l’homme qui tient une plume.
Les fraîches inscriptions qui vous figent soudain la face, qui éclaboussent la tôle, comme du sang frais, nous apprennent ce que ne nous apprendra jamais un traité de rhétorique — la valeur médusante que peut prendre pour l’homme l’acte de dire. Seuls mots pétrifiés, pétrifiants, à l’égal du cri figé des momies pompéiennes.
Il faudrait écrire comme un homme qui se déboutonne dans un chemin sombre, comme un qui écrit sur les murs des urinoirs, comme on expulse sa vie d’un jet avec ces dents serrées et cette face au-delà du marbre, — mais pour une fois sérieux, ah, oui, totalement responsable.